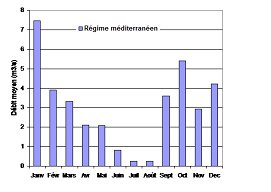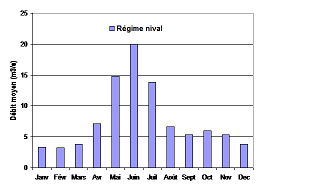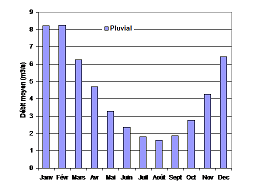Eclusées barrage réservoir Suivis Paramètres biologiques
Retenue :
- En cas de prolifération algale, bilan chlorophylle notamment dans les zones sensibles à l’eutrophisation SDAGE, à savoir zones sensibles et vulnérables
Aval barrage et retenue :
Pour les sites ou ce compartiment est prépondérant, 1 campagne d’études/an en cas de suivi pluriannuel:
- Macrophytes (nature, abondance, % de recouvrement)
- Diatomées (1 campagne d’études) Démarrage du suivi dès la deuxième année aux mêmes périodes, avec protocoles identiques sur mêmes stations que pour l’état initial
Retenue :
Pour les retenues à faible marnage (<2m) : IBL (Indice biologique lacustre) si paramètres déclassant à l’issue du suivi physico-chimique aval pour approcher cycle de transformation de la matière organique
Aval barrage et usine :
- Prélèvements de macro-invertébrés benthiques (Protocole RCS) avec approche quantitative (2 stations au minimum sur 2 à 3 campagnes sur une année.) avec abondances des groupes fonctionnels. Démarrage du suivi trois ans après la mise en service
- Intégration des stations réseau situées sur le bassin versant
- Etude dérive des macro-invertébrés si les peuplements en place montrent un déficit (structure, abondance) ou un dysfonctionnement
- Suivi par réalisation d’inventaires piscicoles sur les stations de l’état initial dans et hors du tronçon court-circuité, dans des conditions d’échantillonnage identiques et à la même période (celle où le recrutement de l’année est mesurable) et dans un délai tel que l’espèce repère ait pu accomplir un cycle biologique complet (3 à 4 ans pour les populations salmonicoles jusqu’à 6 ans pour les populations de cyprinidés d’eau vives. Deux campagnes d’études annuelles peuvent s’avérer nécessaires)
- Prise en compte dans l’analyse des résultats des événements hydrologiques susceptibles d’avoir conditionné le recrutement en juvéniles
- Suivi échouages/piégeages en aval de l'usine selon faisabilité sur le site et intérêt
- Suivi de l’efficacité des ouvrages de franchissement à la montaison (conformité, attractivité, piégeage pour les grands migrateurs…)
- Suivi de l’efficacité des dispositifs de dévalaison par diagnostic de la courantologie (vitesses au plan de grille, guidage vers exutoire de dévalaison…) ou par piégeage ou radiopistage
- En cas de TCC, évolution de sa franchissabilité
- Connectivité avec les tributaires du plan d’eau selon le niveau de marnage
- Evolution des abris en berge et sous berges (nature et importance relative) dans l’éventuel TCC et en aval de l’usine
- Evolution des zones de frayères réelles (comptage des nids) dans l’éventuel TCC et en aval de l’usine en référence à l’état initial, avec station témoin amont
- Suivi précis de la gestion piscicole en liaison étroite avec les AAPPMA